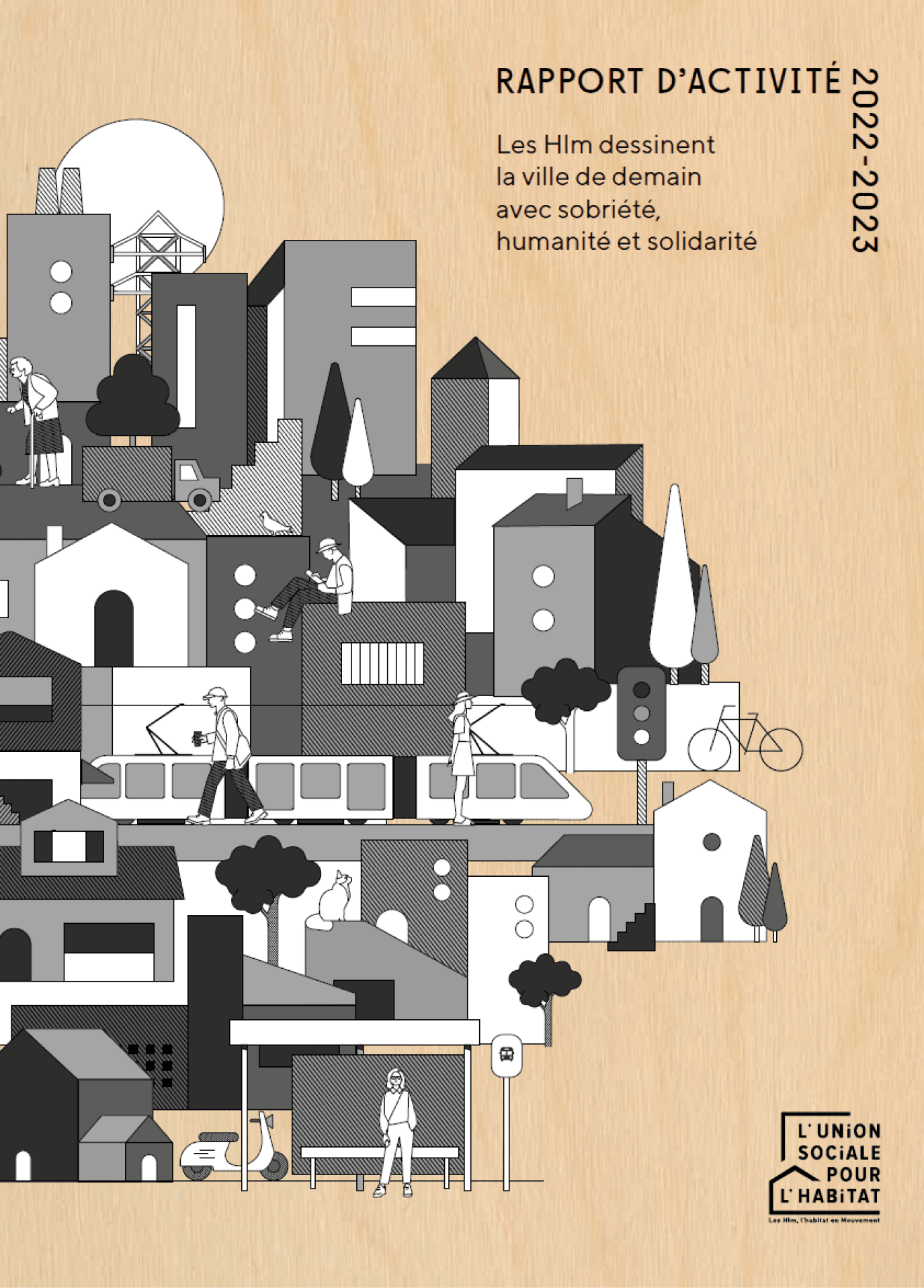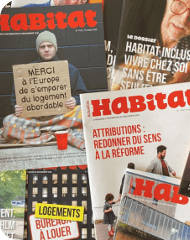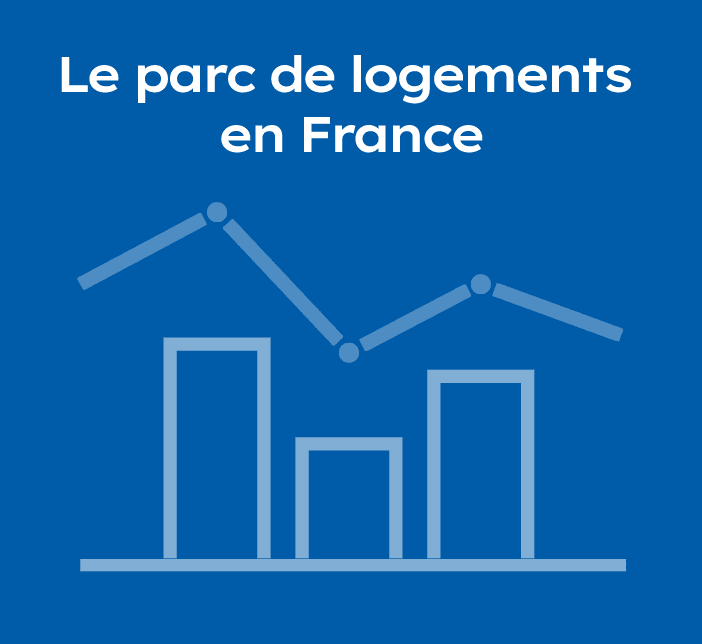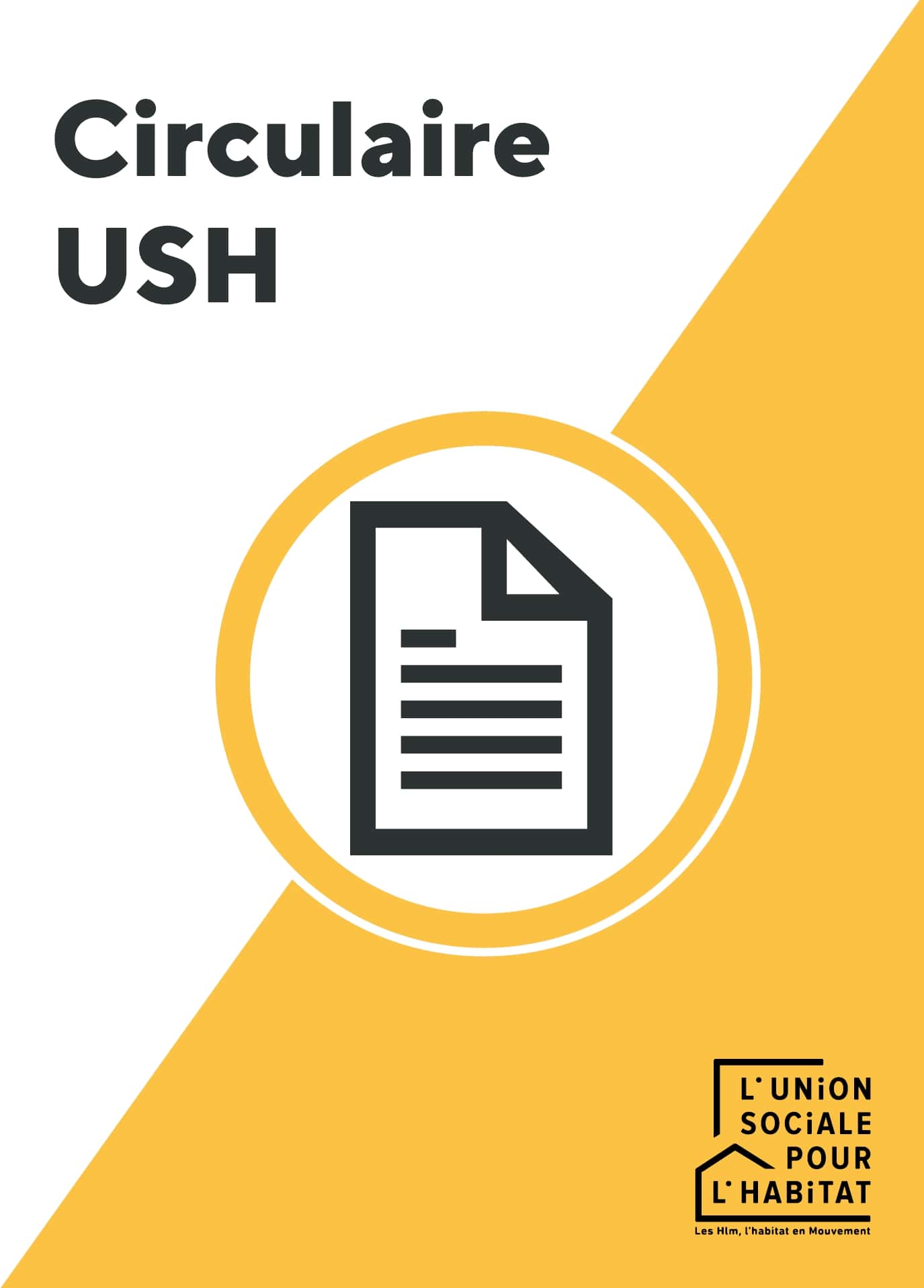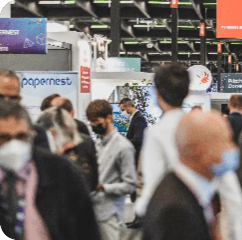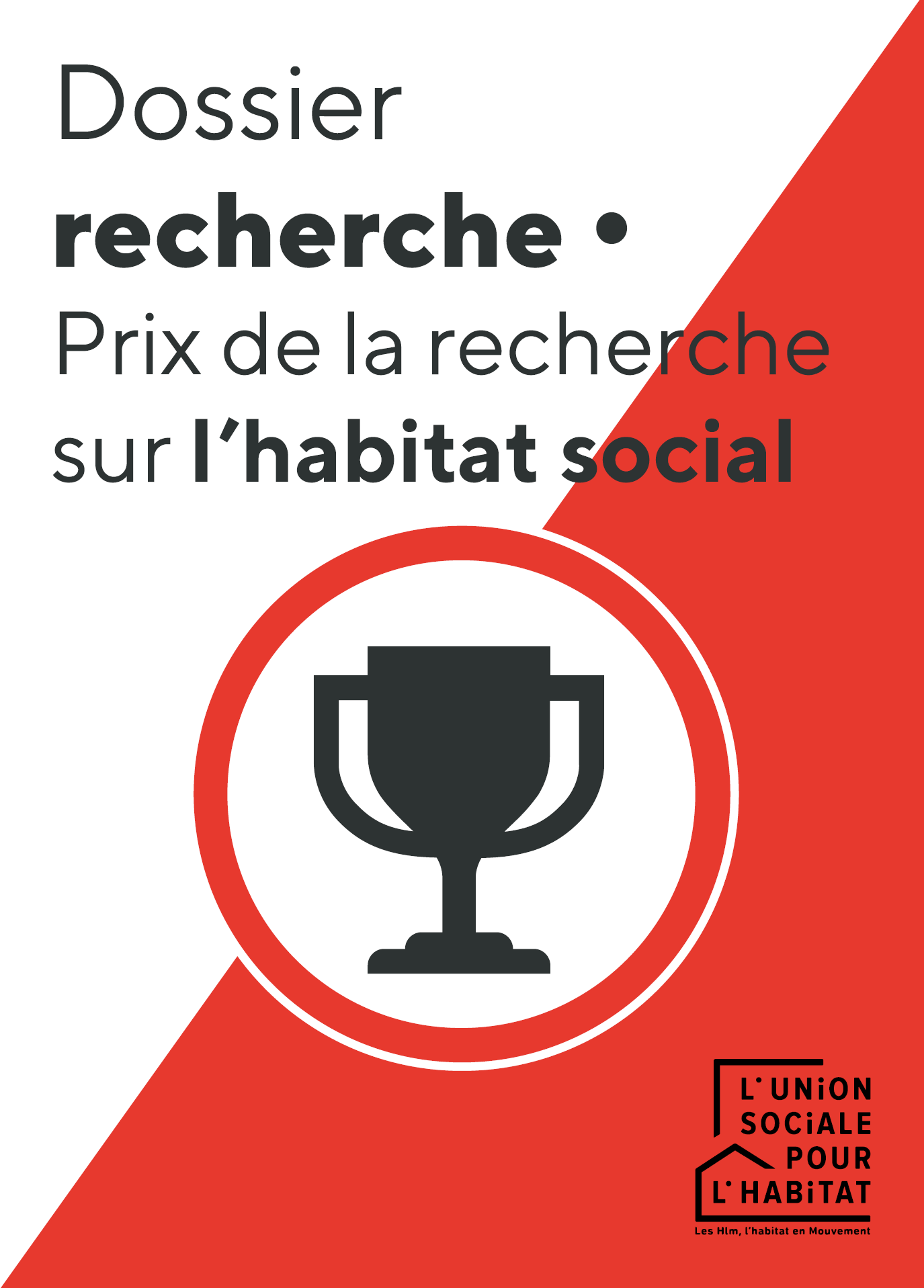Date de publication :
04 février 2019
Auteur(s) :
VICTOR RAINALDI
L'habitat social sous la loupe des chercheurs
Le Réseau des acteurs de l’habitat, en partenariat avec le Réseau recherche habitat logement (REHAL), a organisé le 29 novembre 2018 sa journée annuelle "Quoi de neuf chercheurs ?" autour de deux thèmes(1). Premier épisode : l’évolution de la recherche sur l’habitat.
La présentation critique des travaux de recherche sur l’habitat social depuis 2010 a révélé une réelle concordance avec les préoccupations des acteurs de terrain, qu’ils soient organismes Hlm ou collectivités locales. Sans prétendre à l’exhaustivité, Marie-Christine Jaillet, directrice de recherche au CNRS et coordinatrice du REHAL, a évoqué les grandes orientations de la recherche. L’habitat social fait l’objet d’une mobilisation de disciplines de plus en plus nombreuses et d’une montée en puissance de l’interdisciplinarité (voir Actualités Habitat du 15 janvier 2019 sur le Panorama des recherches en cours). Cela dénote un réel et durable intérêt des chercheurs pour l’habitat social et une volonté d’appréhender de la manière la plus complète possible cet objet protéiforme et riche de sens. Elle souligne aussi un accroissement sensible des coopérations entre chercheurs et acteurs de l’habitat, notamment les organismes Hlm, ainsi qu’une augmentation du volume de travaux financés par ces derniers, mais aussi de manière souvent partenariale par l’Union sociale pour l’habitat, ses Fédérations, le Puca, la Caisse des dépôts, le CGET, le Défenseur des Droits… Le nombre de thèses réalisées dans le cadre des conventions industrielles de formation par la recherche (Cifre) est également en hausse.
Le logement social évolue, la recherche aussi
Sur le fond, il est difficile d’évoquer l’ensemble des contenus qui ont été exposés(2). Il convient cependant de remarquer la profusion de travaux qui portent sur la compréhension des évolutions (sociétales, culturelles, institutionnelles, économiques, technologiques…) de l’environnement des organismes Hlm dont ils souhaitent s’inspirer pour innover et adapter leurs réponses (produits, services, relations aux habitants, organisation, pratiques collaboratives, maîtrise d’ouvrage) en continu. À l’inverse, peu de travaux sont en cours sur le rôle et la place de l’acteur Hlm dans les politiques locales ou nationales du logement. À ce propos, Marie-Christine Jaillet précise que "ces travaux seraient pertinents à l’heure même où les finalités du logement social - logement pour de larges catégories ou pour les plus pauvres - ainsi que la fonction des différents segments du parc et le modèle de production sont réinterrogés." Ces bouleversements, le nouveau contexte qu’ils créent et les interrogations qui en émergent sont toutefois pris en compte par quelques chercheurs. De même qu’il est intéressant de noter une certaine renaissance de travaux d’économie sur le logement social. Jean-Luc Vidon, directeur général d’ICF Habitat La Sablière et président de l’AORIF, voit dans le foisonnement de la recherche sur l’habitat social une véritable source de réflexion pour les acteurs du secteur. "Ces travaux mettent en évidence des tendances de fond, mais savent également attirer notre attention sur ce qui survient. On peut retenir la place donnée aux habitants dans les nombreux travaux portant aussi bien sur la rénovation urbaine que sur l’attribution des logements, les usages du numérique ou la transition énergétique". Cela constitue, pour Jean-Luc Vidon, un "très précieux apport", car "ces travaux décrivent comment les habitants reçoivent les politiques ou utilisent les services conçus pour eux, notamment par les organismes Hlm, constituant une source fertile d’interrogations". Il note également que les travaux liés à l’urgence, à l’hébergement, aux trajectoires vers le logement social, au Logement d’abord font partie des travaux qui se sont renforcés ces dernières années. "Il s’agit d’une nouvelle importante pour les pouvoirs publics et les opérateurs qui travaillent dans les grandes agglomérations et notamment en Île-de-France".
Élargir la recherche sur les politiques territoriales
Si les thématiques de la recherche sur l’habitat et le logement recouvrent assez largement les interrogations des collectivités locales (mixité, peuplement, renouvellement urbain, environnement…), Claire Delpech, responsable des politiques de l’habitat à l’Assemblée des communautés de France (AdCF) a attiré l’attention sur quelques pistes. "Il faudrait engager des recherches sur les politiques publiques du logement en tant que telles, tant au niveau national que territorial, pour mieux voir comment elles se construisent, comment elles fonctionnent, avec quels freins, quels leviers et quels arbitrages, dans un contexte où le jeu des acteurs et des institutions est en transformation." Elle se félicite par ailleurs de la vitalité récente des travaux de recherche sur les problématiques habitat des territoires détendus. La responsable de l’AdCF appelle également à produire des connaissances sur l’articulation des politiques du logement avec les projets territoriaux, les programmes économiques ou la mobilité. Et de souligner que si des travaux existent dans ce domaine, ils sont plutôt conduits par des chercheurs qui ne travaillent pas en priorité sur les questions d’habitat et de logement mais abordent plutôt les questions territoriales avec un spectre plus large.
Le modèle français du logement social :
un vaste champ d’étude
La table ronde qui a ouvert les débats de l’après-midi était consacrée à l’évolution du modèle du logement social et à son financement, thématiques qui ont déjà ouvert un vaste champ de recherches loin d’être épuisé au regard des bouleversements en cours. Loïc Bonneval, maître de conférences en sociologie à l’Université Lyon 2, a cité quelques points clés qui questionnent ce modèle : "Les inquiétudes sur le financement du logement social se sont renforcées avec la réduction de loyer de solidarité (RLS), l’accent mis sur la vente de logements et sur la restructuration des organismes Hlm. La montée en puissance des acteurs privés au travers de la VEFA pose également la question du maintien du savoir-faire des organismes Hlm dans la conception et la construction des logements ainsi que sur les impacts qu’elle peut produire en rompant le lien constructeur et gestionnaire." Parmi les thèmes dont la recherche pourrait se saisir pour aider les acteurs du logement social à éclairer les points forts du modèle, Jean-Luc Vidon a relevé l’évaluation de sa performance en termes de contribution à la cohésion sociale, les effets des aides au logement pour les plus modestes, la capacité d’adaptation du modèle aux nouveaux enjeux tels que l’hébergement d’urgence ou encore la hausse de la construction de logements neufs malgré le désengagement de l’État. Sur ce point, Matthieu Gimat, docteur en aménagement et urbanisme et lauréat du prix de thèse sur l’habitat social organisé par l’USH et la CDC, a présenté les résultats de sa recherche. Lesquels mettent en évidence comment depuis une quinzaine d’années, le modèle du logement social se transforme à bas bruit sous l’effet du "mode de régulation productiviste" mis en place de manière consensuelle par l’ensemble des acteurs pour faire face à la "crise de maturation du secteur"(3). Le résultat de ce processus a conduit à une augmentation forte de la production Hlm ces quinze dernières années mais a fait évoluer le modèle. Une capacité de production qui repose ou a reposé, comme l’a rappelé Pierre Laurent, responsable du développement à la direction des Prêts de la Banque des territoires, sur les aides de la puissance publique (État et collectivités locales), mais "plus encore aujourd’hui sur les fonds propres des organismes Hlm et les prêts de long terme de la Caisse des Dépôts, à des taux compatibles avec la vocation même du logement social". Ce modèle a, dès lors, des impacts positifs en matière sociale et environnementale qu’il serait très difficile, d’atteindre par d’autres moyens. L’apport de la recherche sur ces impacts serait très utile aux acteurs pour développer une argumentation auprès des pouvoirs publics.
Les intervenants ont cité bien d’autres thématiques qui pourraient être placées sous la loupe des chercheurs :
- la vente Hlm : au moment où celle-ci devrait s’amplifier, il serait intéressant de posséder un retour sur une pratique déjà ancienne. Où vend-t-on ? À qui ? Dans quelles proportions et surtout quels sont les effets produits par les ventes déjà effectuées?
- Les parcours résidentiels et les cœurs de ville;
- la mobilité dans le logement social;
- le fonctionnement social des quartiers avant et après la rénovation urbaine.
En conclusion de la journée, Claire Delpech a souligné l’envie de partage et d’échanges ressentie tout au long des travaux. Elle a également invité les participants à être sensibles à "l’intuition" des jeunes chercheurs de manière à se donner la chance de disposer au moment opportun de travaux sur des sujets qui, même s’ils peuvent paraître marginaux aujourd’hui, pourraient se révéler centraux demain. Elle a enfin rappelé que la prochaine journée du Réseau des acteurs de l’habitat "Quoi de neuf, acteurs ?", centrée sur l’actualité du secteur, aura lieu le 20 mars 2019(4).
Contact : Dominique Belargent, USH dominique.belargent@union-habitat.org
(1) "Les modes de coopération acteurs-chercheurs" feront l’objet d’un prochain article.
(2) L’USH publiera les Actes de la journée au premier semestre 2019.
(3) Voir "Une recherche éclairante sur l’évolution du logement social", Actualités Habitat n° 1087, 15 octobre 2018.
(4) Programme et modalités d’inscription sur la page d’accueil du site de l’USH, en événements : www.union-habitat.org
De l’intérêt des comparaisons internationales
Tout au long de la journée, les intervenants ont souligné l’intérêt des comparaisons avec d’autres pays tant pour les acteurs que pour les chercheurs. Certains pays ont déjà pu évaluer les effets de la vente de logements ou de la "résidualisation" du parc de logements sociaux, ou plus fondamentalement encore, les effets des politiques néolibérales dans le domaine du logement social. La question a été débattue de l’évolution de la situation du logement social en France. Matthieu Gimat a développé l’hypothèse d’une forme particulière de néolibéralisme qu’il a définie provisoirement comme "social de projet", soit une évolution du logement social "qui ne viserait plus principalement à aider une large partie de la population à se loger ou à servir de filet de sécurité, mais à faciliter la mise en œuvre de projets professionnels et résidentiels de ménages qui ont les moyens d’en formuler un". Une évolution observée dans de nombreux pays européens, mais dans laquelle la France s’engagerait très certainement différemment puisqu’elle a eu la sagesse de ne pas sacrifier son secteur du logement social.
Pour en savoir plus : www.acteursdelhabitat.com - https://blogs.univ-tlse2.fr/rehal/
Mots clés


PARU DANS ACTUALITÉS HABITAT N°1093 DU 31 janvier 2019
Actualités Habitat n°1093
Retrouvez cet article et beaucoup d’autres en vous abonnant au Magazine Actualités Habitat.